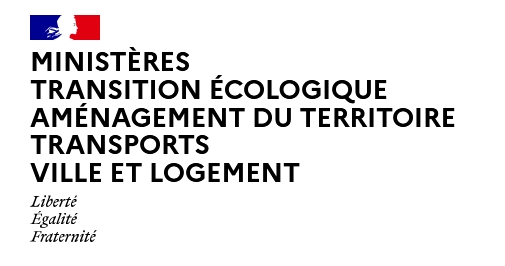Forêt : sauver notre meilleure alliée face au climat
Sécheresses, incendies hors normes… La pression climatique sur la forêt s'accentue, décimant des massifs entiers, mettant à mal la biodiversité et les ressources en bois. Aujourd’hui se joue la survie d’un écosystème à la croisée d’enjeux multiples : écologiques, sociaux, économiques mais aussi climatiques. Car la forêt n’est pas seulement un puits de carbone irremplaçable. Elle aide les territoires à s’adapter au dérèglement climatique. À condition qu’elle-même parvienne à s’adapter.

+80 %
de mortalité des arbres en 10 ans
(Inventaire forestier national (IFN), 2023)
50 %
de la forêt française pourrait avoir changé de visage d’ici 2070,
toutes régions confondues (ONF)
300 000 ha
de forêts déjà dépéris
depuis 2018 à cause des sécheresses. C'est trente fois la superficie de Paris. 670 000 ha supplémentaires sont dépérissant (ONF)
COMPRENDRE
La forêt française : de quoi parle-t-on ?
Des plaines aux zones montagneuses, de la Méditerranée aux Landes, la forêt couvre 41% du territoire français et 31% de l’Hexagone, ce qui en fait la 4e plus grande forêt d’Europe. Elle est aussi la plus diversifiée d'Europe, avec près de 150 essences d’arbres, 120 espèces d’oiseaux ou encore 30 000 espèces de champignons. Sans compter les territoires d’Outremer : la seule forêt guyanaise représente 13% de la biodiversité mondiale.
Cette richesse est un atout pour la France qui a placé de longue date le rôle multifonctionnel des forêts au fondement de sa politique forestière. Car, en plus d’être un précieux réservoir de biodiversité, la forêt concentre de multiples activités (sport, cueillette, chasse…) et fournit le bois utile à la construction, à la fabrication d’objets (meubles, papier, charpentes, emballages...) et au chauffage. Une ressource durable et alternative aux énergies fossiles dont dépend aujourd’hui toute une filière, pourvoyeuse de 440 000 emplois directs.
La forêt n’est pas qu’un peuplement d’arbres !
Au sens biologique du terme, la forêt est un écosystème complexe, dans lequel une multitude de plantes, d’animaux, de champignons et de bactéries interagissent, eux-mêmes reliés aux sols.
Un puits de carbone essentiel, mais pas seulement
La biomasse et les sols forestiers captent aujourd’hui l’équivalent de 15% des émissions de CO2 annuelles du pays. La forêt contribue donc à atténuer le changement climatique. Elle a aussi le pouvoir d’en atténuer les effets. En cas de forte chaleur, les arbres rafraîchissent l’air grâce à l’évapotranspiration (transpiration des feuilles) qui régule le micro-climat local. En libérant de la vapeur dans l’atmosphère, en stockant et filtrant l’eau dans ses sols, elle joue un rôle essentiel dans le cycle de l’eau et notre approvisionnement en eau potable. En cas de fortes précipitations, elle absorbe les pluies et freine leur ruissellement, prévenant ainsi le risque d’inondation, en ville comme en secteur rural.
Partout où elle est présente, la forêt protège les habitants et les biens des risques naturels, y compris dans les secteurs les plus menacés par le changement climatique. Sur le littoral, elle permet de fixer les dunes et de lutter contre l’érosion provoquée par le vent, limitant ainsi le recul du trait de côte et le risque de submersion. En montagne, elle stabilise les sols et constitue un rempart aux risques gravitaires (avalanches, éboulements, glissements de terrain…). Autant de fonctions essentielles aujourd’hui bouleversées par le changement climatique.
La forêt est en crise, ses arbres se dégradent alors qu’elle constitue le principal moyen de stocker le CO2 et l’arme la plus efficace et la moins coûteuse pour affronter le dérèglement climatique.
Mission information sur l’adaptation au changement climatique de la politique forestière et la restauration des milieux forestiers, 2023
Première victime du changement climatique
Depuis près de 20 ans, la santé des forêts se dégrade. Elles souffrent tout particulièrement des épisodes de sécheresse, plus fréquents et plus longs depuis 2018. Avec pour conséquence le dépérissement de nombreuses essences, au premier rang desquelles l’épicéa, le hêtre, le sapin, le frêne, l’orme et plus récemment le châtaignier. Selon l’Inventaire forestier national de l’IGN, près de 670 000 ha de forêts seraient touchés, s’ajoutant aux 300 000 ha ayant déjà dépéri depuis 2018.
En plus de ralentir la croissance des arbres, le manque d’eau les rend plus vulnérables aux attaques parasitaires. Dans l’Est de la France, les scolytes (coléoptères qui se développent sous l’écorce des résineux) ont ainsi décimé le tiers des forêts d’Epicea entre 2018 et 2022. En outre, la sécheresse accentue le risque d’incendie : en 2022, environ 60 000 hectares de forêts ont brûlé contre près de 17 000 en moyenne entre 2011 et 2021, soit 3,5 fois plus.
Au-delà des conséquences sociales, économiques et écologiques, ces événements nous rendent plus vulnérables au changement climatique. Seules des forêts en bonne santé peuvent en atténuer les effets et compenser nos émissions de CO2. Or, d’après l’Académie des sciences, la capacité du « puits de carbone forestier » aurait baissé de 20% en une décennie.

Avec le réchauffement climatique, les parasites profilèrent et déciment les arbres (ici, des larves de scolytes).
Des écosystèmes forestiers pris de court
Les capacités d’adaptation des forêts sont connues. Encore leur faut-il du temps. La brutalité du changement climatique actuel est tout simplement incompatible avec leur mutation naturelle, qui se mesure en décennies, voire en siècles. Selon l'UICN, la vitesse de migration nécessaire pour s’adapter au changement climatique serait de 1 à 7 km par an. Aujourd'hui, les chênes et les hêtres ont besoin de 500 ans pour migrer d'1 km.
Des essences sont certes en train de migrer naturellement vers le nord et de s’installer plus en altitude pour bénéficier d’eau en quantité suffisante et de températures plus fraîches. D'autres comme le chêne sont en train de muter génétiquement. Mais ces évolutions sont trop lentes. D’ici 2050 : le tiers de l’aire actuelle des Chênes, 1re essence de France métropolitaine, pourrait devenir inhospitalière, selon le Ministère de l’Écologie. Parallèlement, les incendies sont amenés à s’intensifier avec une période de risque étalée de juin à octobre et des feux hors norme touchant des surfaces plus étendues et plus proches des habitations. Sans compter la recrudescence d’événements extrêmes tels que les tempêtes ou les cyclones en Outremer.
AGIR
Comment sauver nos forêts ? En vérité, il n’existe aucune solution « clé en main » au regard des incertitudes climatiques, de la complexité des écosystèmes forestiers et des multiples intérêts que concentre ce milieu. Les gestionnaires des forêts sont face à des choix difficiles pour maintenir un équilibre écologique et économique. D’où l’importance d’adopter une démarche concertée, itérative, et fondamentalement à l’écoute des lois de la Nature.
Mobilisation générale pour un nécessaire changement de modèle
La survie des forêts est l’affaire de tous. Si l’État, dont relève la politique forestière, et les collectivités territoriales ont traditionnellement un rôle à jouer, une multitude d’acteurs sont concernés. Professionnels de la filière forêt-bois, scientifiques, institutions et ONG engagées sur le sujet, usagers mais aussi propriétaires privés qui détiennent aujourd’hui 75% des forêts de métropole. La recherche de solutions viables, implique une approche collective, doublée d’une sensibilisation au sens large.
En cela, les Assises de la forêt qui ont rassemblé en 2021- 2022 la quasi-totalité des acteurs de la filière forêt-bois, constituent une première. L’objectif : penser la forêt française de demain. Ces rencontres ont abouti à une feuille de route commune, autour de quatre piliers : soutenir la recherche, pérenniser les financements pour le renouvellement forestier, investir dans l’innovation de l’industrie bois et expérimenter une nouvelle gouvernance par le biais de territoires pilotes. Les 25 mesures de ce plan d’action ont pour la plupart été engagées depuis, dont l’initiative gouvernementale « Planter 1 milliard d’arbres » et son objectif de renouveler 10% de la forêt française en 10 ans.
En savoir plus: consulter les récentes politiques publiques de la forêt.
Premier impératif : sécuriser les forêts saines, leur sol et leur biodiversité
Une forêt résiliente est une forêt en bonne santé. Celles qui stockent le plus de carbone sont aussi les plus anciennes. La meilleure défense face aux effets du changement climatique consiste donc à préserver les forêts d’origine (« vieilles forêts ») ainsi que les arbres sains. Contre les incendies, via le débroussaillage et l’entretien des chemins forestiers. Mais aussi contre d’autres menaces, comme, l’expansion des populations d’ongulés (cerfs, chevreuils, sangliers), friands de jeunes pousses.
Protéger une forêt, c’est aussi protéger son sol et sa biodiversité. Plus un sol est fertile, riche en micro-organismes, plus il aidera la forêt à être résiliente et productive. Plus on y touche, plus on l’appauvrit. Limiter son tassement par les engins d’exploitation est essentiel pour garantir l’infiltration de l’eau nécessaire aux arbres. De même, conserver les bois morts, qui abritent 25% de la biodiversité forestière, permet au sol de se régénérer.
La biodiversité est vitale pour la forêt : une étude récente associant le CNRS démontre que plus sa palette végétale est variée, plus la forêt résiste aux sécheresses. Ainsi, gérer de façon la plus naturelle possible, de manière à protéger les sols et la biodiversité, sont des éléments clés de la résilience des écosystèmes forestiers. A l’heure actuelle, près de 70 % de la forêt est gérée selon les principes de la régénération naturelle : on laisse la forêt se reconstituer spontanément grâce à ses arbres semenciers, avec des interventions à la marge pour favoriser certaines espèces.
Diversifier les essences
Parce que la forêt manque de temps pour migrer et s’adapter, au regard des besoins humains, une intervention humaine semble nécessaire. Oui mais comment faire ? Aujourd’hui, nul ne peut prédire avec exactitude comment le climat évoluera ni quelles essences résisteront demain. Reste une vérité indiscutable : une forêt diversifiée sera toujours mieux armée contre les aléas climatiques. Les ravageurs, souvent spécifiques à une espèce, y font par nature moins de dégâts. Les incendies s’y propagent moins vite), contrairement aux mono-cultures, décimées par des incendies sans précédent ces dernières années.
Faire cohabiter des arbres d’âge, d’essence et de taille variés, introduire de la diversité là où elle fait défaut : ce principe guide désormais la politique de l’ONF. « Nous prônons le mélange d’essences en enrichissant les parcelles en régénération naturelle sur des zones à faible densité. Nous espérons qu’au moins une ou deux d’entre elles survivront à long terme. Il faut éviter de mettre tous ses œufs dans le même panier », explique Erwin Ulrich, pilote national de l'adaptation des forêts au changement climatique à l'ONF. Autre pratique qui se développe : l’enrichissement des forêts monospécifiques.
Quelles essences planter ? Pour éclairer les choix des forestiers, l'application ClimEssences du réseau Aforce permet de visualiser l'incidence des modèles climatiques sur la probable répartition géographique d'un très grand nombre d'essences.
Exploiter le bois autrement, en respectant la nature
S'adapter au changement climatique impose une évolution du mode de sylviculture pour des raisons écologiques mais aussi économiques. "A cause du changement climatique, toutes les essences vont diminuer leur croissance, la production de bois a déjà commencé a diminué", constate Erwin Ulrich. « Plus le changement climatique va s’accentuer, plus les gestionnaires devront s'orienter vers des essences résilientes, capables de tenir dans le temps, plutôt que productives ». Le modèle de la monoculture (planter des arbres du même âge, de la même espèce, souvent du résineux) est à délaisser. De même, que la coupe rase, cette technique, qui consiste à abattre la totalité des arbres d'une même parcelle. Elle malmène le sol en mettant subitement à nu une forêt et en retournant la terre avec des engins lourds. Et elle accroît les températures. Elle est d'ailleurs interdite dans certains pays comme la Suisse.
Mieux vaut s'orienter vers des pratiques plus naturelles, fondées sur le mélange d’essences, à l’instar de la sylviculture mélangée en couvert continue. Dite aussi « futaie irrégulière », cette pratique associe à la régénération naturelle de la forêt des prélèvements en bois ciblés et répartis dans le temps. En évitant les « coupes rases », elle préserve le sol (les souches ne sont pas arrachées) et un couvert boisé permanent, avec des arbres de taille et d’âge différents. Cette sylviculture « douce » se concentre sur la production d’arbres de qualité. Mais attention, elle ne peut se déployer que sur certains types de sols.
Désormais, les forestiers doivent faire passer la résilience des forêts avant la productivité.
Erwin Ulrich, pilote national de l'adaptation des forêts au changement climatique à l'ONF
Expérimenter avec prudence, intervenir avec finesse
La connaissance des arbres et des sols est encore parcellaire. L’observation sur le terrain est donc clé pour comprendre et suivre l’évolution des forêts. C’est tout le sens de la création, en juillet 2023, de l’Observatoire des forêts françaises. Les espaces laissés en libre évolution (affranchis de toute intervention humaine) peuvent servir à observer la migration naturelle de la forêt.
Il s’agit d’accepter de gérer la forêt avec un fort degré d’incertitude. Ceci implique une approche prudente et adaptative, un suivi rigoureux, en lien avec la recherche ainsi qu’un partage des réussites et des échecs. Le principe de précaution doit prévaloir pour les expérimentations comme la migration assistée, qui consiste à tester sur certaines parcelles, l’acclimatation d’essences adaptées à des climats plus chauds et secs. Les risques de mal-adaptation ou d’invasion biologique ne sont pas exclus, notamment s’agissant de l’implantation d’espèces exotiques, souligne le Comité français de l’UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) dans ses notes 2024.
Pas de solution miracle. Gérer la forêt implique de recourir à un ensemble de solutions complémentaires, les plus adaptées aux écosystèmes forestiers des territoires concernés et à leurs enjeux locaux. Le concept de « forêt mosaïque, prôné par l'Office National des Forêts (ONF) et ses partenaires, s’inscrit pleinement dans cette dynamique. Ce nouveau mode de gestion vise à assurer une résistance optimale des forêts, tout en maintenant la production de bois et les activités de loisirs. Une équation complexe à laquelle toutes les forêts françaises ou presque sont aujourd’hui confrontées.
La forêt mosaïque,
nouvelle ligne de conduite de l'ONF
Des îlots de vieillissement avec des arbres de plus de 200 ans, des zones humides, des zones "tests" de nouvelles essences, des zones de production de bois... la forêt mosaïque est un kaléidoscope de milieux forestiers pour augmenter la résilience face au changement climatique et la biodiversité ». Les plans de gestion précisent la distribution entre espaces non boisés, espaces boisés non exploités et espaces boisés exploités.