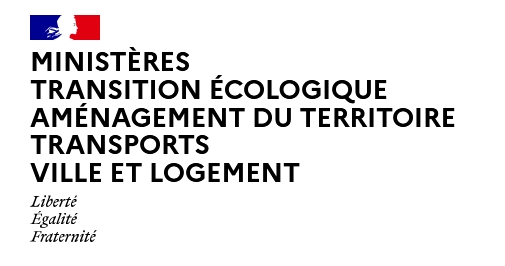Les infrastructures de transport face au climat : la nécessaire adaptation
Routes fissurées, rails déformés, ponts emportés par les catastrophes naturelles… On commence à prendre la mesure des effets du changement climatique sur nos infrastructures de transport, construites pour la plupart au siècle dernier. Pour accélérer la prise de conscience et surtout planifier l’immense chantier que constitue l’adaptation des routes et du rail au changement climatique, les collectivités comme les gestionnaires sont encouragés à agir.

X 6
en 2050
Le coût des dommages sur le transport sera multiplié par trois d’ici 2035, et par six d’ici à 2050 en raison des aléas climatique
(source : Carbone 4)
- 30 à 50 %
C’est la baisse de durée de vie
déjà observée pour les infrastructures de transport en montagne à cause des conditions climatiques
(source : Cour des comptes)
206
tronçons routiers
détruits en France d’ici à 2050, à cause de l’érosion des côtes
(source : Cerema)
COMPRENDRE
De quoi parle-t-on ?
Les infrastructures de transport désignent l’ensemble des installations et des ouvrages nécessaires pour la circulation des véhicules et le fonctionnement des systèmes de transport. Concrètement il s’agit principalement des routes, des ponts, des tunnels, des rails mais aussi des gares, des ports et des aéroports.
Le réseau routier français avec ses 1,1 million de kilomètres représente ainsi le premier réseau de transport en France, devant le rail et ses 33 000 kilomètres de voies. Il est aussi le plus fréquenté. Ces infrastructures sont stratégiques en termes de cohésion territoriale et de vitalité économique. Ce dossier propose un focus sur les rails et les routes.
Des phénomènes extrêmes de plus en plus destructeurs
Le changement climatique touche nos infrastructures routières et ferrées bien plus qu’on ne l’imagine. Les tempêtes ou les cyclones peuvent couper des routes, des voies ferrées, détruire ou emporter des ponts. Les épisodes “méditerranéens ou cévenols” transforment en quelques minutes un cours d’eau en un redoutable torrent, capable d’emporter les bâtiments et les infrastructures sur son passage.
Sans compter, les glissements de terrain avec la fonte du pergélisol (permafrost en anglais) en montagne qui peuvent jusqu’à détruire des tunnels, des rails ou des routes comme dans la Maurienne. Bien que ces phénomènes ne soient pas nouveaux, leur intensité et leur fréquence augmentent ces dernières années. Ce sont par exemple 53% des départements français qui ont été touchés entre novembre 2023 et juin 2024 par une inondation, plus d’un département sur deux.
Les crues torrentielles et les feux de forêt, on connaît mais ça devient plus fréquent. (...) Des territoires autrefois à l’abri ne le sont plus David Zambon | directeur général adjoint du Cerema
Le coût de ces catastrophes est toujours plus important en réparation, pertes de recettes ou socio-économiques, comme le révèle cette étude d’I4CE. Leurs impacts se chiffrent rapidement en millions voire en dizaines de millions d’euros lors d’une interruption sur un axe majeur. Par exemple en 2016, 10 jours de suspension de trafic pour inondation sur l’A10 ont coûté 4,9 millions d’euros en pertes de péages à Cofiroute ; la rupture d’un pont routier comme le Viaduc du Var a généré 40M€ en pertes socio-économiques en 2017 ( source : CGDD). La seule tempête Alex en octobre 2020 a engendré 25 millions d’euros en réparation pour SNCF réseau (source : Cour des Comptes 2024).
Au-delà des dégâts matériels et des pertes économiques, les conséquences de ces dommages pour les populations peuvent être considérables. En cause les tronçons routiers et ferroviaires fermés qui vont isoler les communes, provoquer des difficultés d’approvisionnement, d’accès aux soins ou de communication. Les villages des vallées de la Roya, de la Vésubie et de la Tinée dans les Alpes-Maritimes, ont été coupés du monde pendant plusieurs jours, certains pendant plusieurs mois suite à la tempête Alex. Plus communément, les intempéries sont la première cause externe des retards de la SNCF en 2022 (près de 20% des “minutes perdues”) selon la Cour des comptes.
Le changement climatique accélère aussi le vieillissement des infrastructures
Si les infrastructures ne sont pas systématiquement détruites, elles sont de plus en plus fragilisées par les effets du dérèglement climatique.
Prenons les canicules. Sur les routes, certains bitumes peuvent fondre si la chaussée dépasse les 40°C. On assiste alors à des phénomènes de “ressuage ” : les liants remontent à la surface et créent des bandes noires et molles qui viennent adhérer aux pneus. Un phénomène dangereux, surtout pour les deux roues ou les camions qui vont “arracher la route”. Les vagues de chaleur attaquent aussi les rails et les caténaires, perturbant le trafic ferroviaire. En effet les rails sont en acier. Quand la température extérieure atteint 37°C, celle du rail est de 55°C : il peut se déformer.
L'alternance de sécheresses et de pluies peut aussi provoquer des fissures et déformer les chaussées en raison du phénomène de retrait-gonflement des sols argileux.
Quant au recul du trait de côte, selon une étude récente du Cerema, il menace de destruction 206 tronçons routiers en France (essentiellement des routes départementales) d’ici à 2050.

AGIR
Avec l’accélération du changement climatique, l’heure n’est plus à la réaction mais à l’anticipation. Intégrer cet enjeu à chaque étape de vie des infrastructures, de leur conception à leur exploitation, est devenu incontournable. Conscients du sujet, pouvoirs publics et opérateurs mènent des études de vulnérabilité et élaborent leurs stratégies d’adaptation. A leur disposition, un mix de solutions possibles, qui reste à calibrer selon les priorités et les moyens.
Quelles solutions pour améliorer la robustesse des réseaux de transports ?
La robustesse d’un réseau de transport passe d’abord par son entretien régulier. Mais il s’agit d’aller plus loin, de construire et de rénover autrement les infrastructures en anticipant les risques climatiques. Cela passe par l’adoption de nouvelles normes de construction : surélever des bâtiments en zone inondable ; renforcer des fondations des ouvrages d’art ; utiliser des matériaux plus résistants ou des systèmes de drainage plus performants sur les routes, par exemple.
Miser sur une maintenance et une exploitation agiles et préventives
La stratégie ne repose pas uniquement sur des grands travaux. Les mesures « en dur » sont à compléter avec des mesures organisationnelles moins coûteuses (estimées à quelques dizaines de millions d’euros annuels selon I4CE). Côté maintenance par exemple, peuvent être mis en place : la surveillance météo, la télégestion de l’état des ouvrages ou l’entretien différencié selon l’exposition des infrastructures (comme le nettoyage renforcé des ouvrages d’évacuation des eaux avant les pluies intenses). Chez SNCF Réseau, des agents sont mobilisés jour et nuit pour des “tournées de chaleur” pour surveiller les impacts sur les rails, les caténaires et la signalisation. Ils surveillent aussi les départs de feu de talus, lors des des canicules ou fortes sécheresses.
Côté exploitation, des “stop circulations” sont possibles chez SNCF réseau quand les risques sont trop grands. Dans les Alpes, certaines routes sont désormais fermées temporairement après de fortes précipitations, pour éviter les risques d’éboulements. D’autres actions se développent: diversifier les itinéraires de transport, modifier les horaires de circulation, préférer le télétravail quand les conditions de circulation sont trop difficiles. Peu à peu les populations se familiarisent avec de nouvelles façon de se déplacer face aux risques climatiques.
Prévenir les risques à l’échelle de la zone toute entière
Certaines solutions seront à rechercher au-delà des infrastructures elles-mêmes : supprimer des arbres menaçant les caténaires SNCF; gérer les écoulements des eaux pour prévenir les risques d’inondation (la meilleure réponse peut être de traiter un bassin et non de surdimensionner un viaduc) ; surveiller l’usage des sols à proximité des voies : le cas s’est déjà produit où l’imperméabilisation d’une parcelle riveraine a perturbé l’écoulement des eaux de pluie et provoqué une forte inondation sur un rail.
Les solutions fondées sur la nature viennent réduire le risque en amont. Face au risque inondation, par exemple. Dans la vallée de la Maurienne, le torrent de l’Arc, affluent de l’Isère menace régulièrement les infrastructures à proximité. Parmi les travaux entrepris, l’élargissement de son lit vise à limiter la la force des crues. Autre illustration : en Bretagne, SNCF Réseau collabore avec les agriculteurs pour les inciter à planter des haies pour retenir l’eau.
La nature au secours des routes : l’exemple de la Savoie
Le Département fait appel au « génie végétal » pour prévenir les glissements de terrain et les coulées de neige sur la route d’accès à Tignes. La solution ? La technique du “gratta viva” qui consiste à revégétaliser le talus. Les racines se fixeront dans le sol et les végétaux prenant de l’ampleur limiteront l’érosion. Coût total du chantier mené avec l'Office national des forêts : 650 000 €.
Dans certaines situations, il s’agira d’accepter le risque : par exemple la possibilité que l’eau submerge temporairement la chaussée en faisant un minimum de dégât. Dans les cas extrêmes, il s’agira de renoncer définitivement. D’ores et déjà, par exemple, le Pays Basque a accepté que l’érosion côtière condamne certaines portions de ses routes mythiques comme la corniche Nord de saint-Jean-de-Luz au Pays Basque.
Le défi : bien calibrer la réponse en s’appuyant sur des diagnostics précis et partagés
Face au changement climatique, différentes réponses sont donc envisageables. Au cas par cas il est possible de mixer les solutions. A moyens budgétaires limités, la collectivité devra prioriser. Mener une analyse de vulnérabilité lui permettra d’identifier les réseaux les plus exposés aujourd’hui et d’anticiper l’évolution possible des aléas. Il est aussi clé pour le territoire d’identifier les enjeux de ces réseaux - très fréquentés, utilisés couramment par les services de secours, etc. Face à l’urgence de la situation, il s’avère indispensable d’accélérer ces diagnostics pour savoir quelles infrastructures sont menacées, à quel degré, hiérarchiser et planifier les interventions nécessaires.
C’est le sens de la mesure 30 du PNACC 3 qui impose aux entreprises du secteur de prévoir des plans d’adaptation d’ici à 2026. L'objectif est d'aboutir peu à peu à des plans d'actions détaillant les budgets nécessaires aux actions d'adaptation et, à terme, d'adopter un plan unifié pour tous les gestionnaires d'infrastructures et opérateurs de transport des territoires.
Pour aider les gestionnaires de transport à planifier leurs besoins, le Cerema a développé une méthode en 10 points: l’ASAIT (Approche systémique de l'adaptation des infrastructures de transport). Cette méthode a été appliquée par SNCF réseau, qui depuis quelques années a intégré la résilience au changement climatique dans la gestion de ses infrastructures. Pour ce faire, elle a progressivement réalisé des analyses de vulnérabilité pour identifiés des solutions d’adaptation sur plusieurs lignes : SNCF Axe Seine, les nouvelles lignes Montpellier-Perpignan ou Bordeaux-Toulouse, les lignes d’Occitanie et de Bretagne-Pays-de-la-Loire. Elle forme aussi ses collaborateurs à ces enjeux. Lire : la stratégie d’adaptation de SNCF Réseau
Certaines mesures peuvent demander une coopération à une échelle plus large que celle de la collectivité et donc, des dialogues avec des élus et services techniques d’autres collectivités. Par exemple, pour réduire les risques d’inondation, des zones d’expansion des crues peuvent être identifiées. Ces actions doivent pouvoir ensuite se négocier au moment opportun, par exemple lors de la mise à jour de document de planification à large échelle.
Préserver les réseaux de transports sur les territoires implique de nombreux acteurs tant du côté des gestionnaires que des autorités organisatrices (Etat, Collectivités). La réflexion a donc tout intérêt à être menée de façon élargie, dans le cadre d’une gouvernance ouverte, à l’instar de celle déployée par la région Provence Alpes-Côte d’Azur, qui innove en abordant le sujet de façon multimodale.
La région PACA, chef de fil d’une démarche partenariale unique en France
La région Provence Alpes Côte d’Azur est ce qu’on appelle un “point chaud” des risques climatiques. Menacée par l’érosion du trait de côte et les submersions marines, sujette aux canicules et aux incendies, aux mouvements de terrain et aux pluies intenses, elle est en première ligne. C’est pourquoi la région a engagé une démarche inédite pour évaluer la vulnérabilité de toutes ses infrastructures de transports : routes, voies ferrées, maritimes et aériennes. Cette démarche associe la Région, l’État, les gestionnaires de tous les réseaux et services de transport concernés. Objectif : identifier les réseaux critiques et élaborer une stratégie d’adaptation commune et multi-partenariale. Pour ce faire, la Région s’est appuyée sur la méthode pilote développée par le Cerema, l’ASAIT (Approche systémique de l'adaptation des infrastructures de transport). Le diagnostic est en cours.